Des communautés européennes en voie de disparition...
par Robert Steuckers
Recension: Karl-Markus GAUSS, Die sterbenden Europäer, Unterwegs zu den Sepharden von Sarajevo, Gottscheer Deutschen, Arbëreshe, Sorben und Aromunen, Mit Photographien von Kurt Kaindl, DTV, München, Nr.30.854, 2011 (5. Ausgabe), ISBN 978-3-423-30854-0.
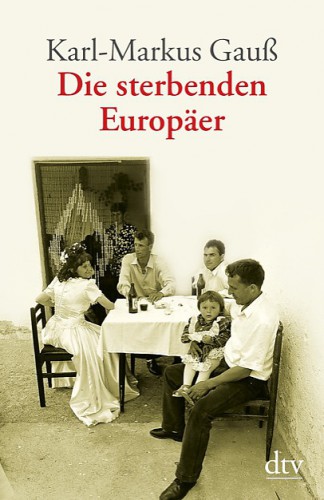 Dans
l’ABC politique qui nous est cher, déplorer avec anxiété la disparition
des faits communautaires, des communautés humaines réelles, de chair et
de sang, est une constante, couplée à une anthropologie pessimiste qui
ne voit pas de “progrès” dans leur disparition mais qui constate,
amèrement, que ce que l’on baptise “progrès” est en réalité une terrible
“régression” dans la diversité humaine. Bon nombre d’ethnologues,
d’écologistes, d’anthropologues déplorent, à très juste titre, la
disparition de langues et de petites communautés ethniques dans la
jungle d’Amazonie ou dans les coins les plus reculés de Bornéo ou de la
Nouvelle-Guinée. Mais ce triste phénomène se passe en Europe aussi, sous
l’oeil indifférent de toutes les canailles qui donnent le ton, qui
détiennent les clefs du pouvoir politique et économique, qui n’ont
aucune empathie pour les éléments humains constitutifs d’une réalité
charnelle irremplaçable si elle venait à disparaître. Pour se rappeler
que le phénomène de la “mort ethnique” n’est pas seulement d’Amazonie ou
d’Insulinde, il suffit de mentionner la disparition des Kachoubes, des
Polaques de l’Eau ou des derniers locuteurs de la vieille langue
prussienne (du groupe des langues baltiques), suite à la seconde guerre
mondiale.
Dans
l’ABC politique qui nous est cher, déplorer avec anxiété la disparition
des faits communautaires, des communautés humaines réelles, de chair et
de sang, est une constante, couplée à une anthropologie pessimiste qui
ne voit pas de “progrès” dans leur disparition mais qui constate,
amèrement, que ce que l’on baptise “progrès” est en réalité une terrible
“régression” dans la diversité humaine. Bon nombre d’ethnologues,
d’écologistes, d’anthropologues déplorent, à très juste titre, la
disparition de langues et de petites communautés ethniques dans la
jungle d’Amazonie ou dans les coins les plus reculés de Bornéo ou de la
Nouvelle-Guinée. Mais ce triste phénomène se passe en Europe aussi, sous
l’oeil indifférent de toutes les canailles qui donnent le ton, qui
détiennent les clefs du pouvoir politique et économique, qui n’ont
aucune empathie pour les éléments humains constitutifs d’une réalité
charnelle irremplaçable si elle venait à disparaître. Pour se rappeler
que le phénomène de la “mort ethnique” n’est pas seulement d’Amazonie ou
d’Insulinde, il suffit de mentionner la disparition des Kachoubes, des
Polaques de l’Eau ou des derniers locuteurs de la vieille langue
prussienne (du groupe des langues baltiques), suite à la seconde guerre
mondiale.
Karl-Markus
Gauss, né en 1954 à Salzbourg, est aujourd’hui le directeur de la revue
“Literatur und Kritik”. Ses livres sont traduits en de nombreuses
langues et obtiennent souvent des prix très prestigieux. “Die sterbenden
Europäer” part d’un axiome philosophique fondamental: l’Europe doit sa
dimension plurielle, sa qualité culturelle intrinsèque, à l’existence de
ces communautés battues en brèche, laminées sous les effets délétères
de la pan-médiatisation —qui, comme l’avait prévu Heidegger, allait
induire les hommes à oublier ce qu’ils sont vraiment, à ne plus river
leurs regards sur les chemins de leur lieu natal— du “tout-économique”,
des idéologies réductrices et universalistes, et, enfin, des avatars du
jacobinisme étatique et éradicateur qui ne cesse de sévir.
La communauté sépharade de Sarajevo
Gauss
commence par évoquer la communauté sépharade de Sarajevo, issue de la
diaspora venue de l’ancienne Espagne musulmane, après la chute de
Grenade en 1492 et les autres expulsions qui se sont succédé jusqu’aux
premières années du 17ème siècle. La langue espagnole, castillane, s’est
perpétuée à Sarajevo jusqu’en 1878, où une autre communauté juive,
celle des Achkenazim germanophones, va donner le ton et administrer la
Bosnie auparavant ottomane. Les Sépharades de Sarajevo tombaient de
haut, en voyant arriver de drôles de coreligionnaires non hispanophones,
et n’ont guère montré d’enthousiasme quand il s’est agi, pour eux, de
céder la place à ces nouveaux venus qu’ils ne considéraient pas vraiment
comme étant des leurs. La guerre de Bosnie commence le 5 avril 1992
précisément par le coup de feu d’un “sniper” embusqué dans le vieux
cimetière juif de la ville, aux innombrables tombes portant des poèmes
en “spaniole” et aux quelques tombes achkenazes, évoquant des noms
hongrois, autrichiens ou bohémiens. Plus tard, l’artillerie des
assiégeants s’y arcboutera pour pilonner la ville. Pour empêcher tout
assaut contre les pièces, le cimetière a été miné. Il a fallu six mois à
une association norvégienne pour enlever les mines. La guerre de
Bosnie, et la guerre de 1999 contre la Serbie, qui s’ensuivit, ont donc
éradiqué une communauté ancienne, détentrice d’une certaine mémoire
d’Espagne transplantée en terres balkaniques. Des 1500 juifs de
Sarajevo, 750, les plus jeunes, ont quitté définitivement la ville. Un
témoin issu de cette communauté judéo-spaniole, officier instructeur de
l’aviation militaire yougoslave, ingénieur et concepteur de drônes avant
la lettre, témoigne du départ de tous les jeunes et dit de lui: “Je ne
suis pas Israélien, pourquoi donc irais-je en Israël? Je ne suis pas
Américain, pourquoi irais-je maintenant en Amérique ... pour y mourir?”.
Gauss
tire la conclusion: toutes les factions belligérantes s’étaient mises
d’accord pour évacuer les Juifs de Sarajevo sous la protection de l’ONU.
Ce ne fut donc pas une nouvelle forme d’antisémitisme mais bien un mode
nouveau de “philosémitisme” qui porta la responsabilité de cette
éradication ethno-communautaire. Le témoin, Moshe Albahari, est clair:
il n’y avait pas d’antisémitisme en Yougoslavie ni au sein des factions
qui s’entretuaient dans la guerre inter-yougoslave des années 90. Toutes
ses factions entendaient protéger la communauté sépharade: elles se
haïssaient tellement, qu’il n’y avait plus de place pour d’autres haines
en leurs coeurs, précise Albahari. Mais la Bosnie indépendante et
divisée, née des conflagrations inter-yougoslaves, est une “entité à
drapeaux”, des drapeaux particularistes, à laquelle Albahari, sépharade,
ottoman et yougoslavo-titiste, ne peut s’intéresser. Question: ces
“drapeaux particularistes” n’ont-ils pas été, paradoxalement, voulu par
les théoriciens de l’universalisme pour installer à terme —car tel était
le but véritable de la manoeuvre— l’armée américaine dans les Balkans,
plus précisément au Kosovo, autre entité étatique nouvelle à idéologie
“particulariste” (islamo-albanaise)? Par voie de conséquence, ces
idéologies universalistes, tant prisées par les intellocrates et les
médiacrates de la place de Paris, y compris les intellocrates sionistes
ou judéophiles, ne sont-elles pas les premières responsables, avec leurs
commanditaires de Washington, de la disparition de la vieille
communauté sépharade de Sarajevo, en dépit du fait que ces intellocrates
chantaient les louanges du modèle unificateur et polyethnique de la
ville? Une ville qui deviendra essentiellement musulmane, non pas selon
un islam ottoman (et tolérant), au sens ancien du terme, mais, comme le
souligne Gauss (p. 42), sur un mode néo-islamiste, djihadiste, financé
par les Wahhabites saoudiens qui n’ont pas la moindre affinité avec
l’islam “spaniole” en exil. Nous touchons là à l’un des paradoxes les
plus tragiques de la dernière décennie du 20ème siècle.
Les Allemands du Gottschee
Pendant
600 ans, une communauté allemande a défriché la forêt du “petit pays”,
le Gottschee, 850 km2, et l’a transformé en terres arables et fertiles.
Il n’a pas fallu cinquante ans pour que la forêt reprenne tous ses
droits et que les villages, jadis florissants, soient devenus
inaccessibles derrière un écran touffu d’arbres et de sous-bois. Le
Gottschee n’est pourtant pas loin: il se trouve en Slovénie dans le
district administratif de Kocevje, à une heure de route de la capitale
Ljubljana (Laibach). Le village de Verdreng, comme beaucoup d’autres, a
aujourd’hui disparu, à une ou deux maisons près, où vivent encore une
poignée d’Allemands, vestiges humains d’un passé totalement révolu.

Leur
communauté, réduite aujourd’hui au minimum du minimum, s’était
constituée au 14ème siècle et, à force de défricher une forêt
particulièrement dense, avait fini par bâtir 171 villages agricoles où
la culture des céréales et des fruits ainsi que l’élevage du bétail
étaient pratiqués. Ces paysans venaient de Carinthie ou du Tyrol
oriental; il étaient surtout des cadets de famille, condamnés, en
d’autres circonstances, à la domesticité ou au mercenariat: s’ils
cultivaient leurs terres pendant neuf ans et un jour, elles leur
appartenaient définitivement. Une aubaine dont tous voulaient profiter.
Après la grande peste de 1348, qui décime la moitié de la population, le
recrutement de nouveaux venus s’effectue en des régions germaniques
plus lointaines: le reste du Tyrol, la Franconie et même la Thuringe. En
1492, l’Empereur Frédéric III leur accorde le privilège de devenir
marchands itinérants dans la zone alpine, ce qu’ils sont restés jusqu’au
lendemain de la seconde guerre mondiale, participant ainsi au
désenclavement de leur communauté et en lui apprenant les choses du
vaste monde, en modernisant leur allemand médiéval. Leur manière de
commercer est demeurée la même au cours de ces cinq siècles: elle était
basée sur la seule force physique du colporteur, qui avait sur le dos un
“kraxn”, dispositif de bois permettant de porter une charge, un peu
comme celui des Franc-Comtois qui transportaient loin vers la Bourgogne,
la Champagne ou le Lyonnais des pendules fabriquées à Morteau ou dans
les villages du “Pays horloger”. Les natifs du pays de “Gottschee”
partaient peut-être au loin mais ils restaient fidèles à leur site
d’origine, au “là” de leur Dasein, pour parler comme le Souabe Heidegger.
Cette
communauté de Gottschee, théoriquement libre, souffrira
considérablement du pouvoir des familles qui prendront misérablement le
relais des Ortenburg, qui les avaient fait venir en Slovénie, dans
l’arrière pays du diocèse d’Apulée, et leur avaient accordé le droit de
devenir pleinement libres au bout de quelques années de labeur à peine.
Pire: quand les armées ottomanes ravageaient la région, elles pillaient
les réserves et emmenaient les paysans allemands en esclavage pour les
faire trimer en Anatolie et les y dissoudre dans une population
hétéroclite et bigarrée qui n’avait qu’un seul dénominateur commun:
l’esclavage. En 1640, les Comtes d’Auersperg héritent du pays et
décident de le développer: l’âge d’or du pays de Gottschee vient alors
de commencer pour se terminer au lendemain de la Grande Guerre. Au 18ème
siècle, les idées éclairées de l’Impératrice Marie-Thérèse et de
l’Empereur Joseph II contribuent au développement de ces Allemands de
souche exclavés, vivant de leur agriculture traditionnelle et autarcique
et de leur commerce réduit à l’aire alpine et véhiculé à dos d’homme.
Au 19ème siècle, cette communauté isolée envoie tant de ses enfants en
Amérique qu’il y aura plus de “Gottscheer” au-delà de l’Atlantique en
1920 que dans le pays lui-même. Le premier Etat yougoslave commence une
politique de “slovénisation” et de “dégermanisation” forcée, tant et si
bien que lorsque les autorités nationales-socialistes rassemblent la
population pour la déplacer à l’intérieur des frontières du Reich, les
jeunes gens du pays ne parlent quasiment plus l’allemand: leur langue
natale est si mâtinée de slovène que leurs voisins autrichiens ne les
comprennent plus.
Pendant
l’hiver 1941/1942, Hitler —qui, ici, ne se fait pas le défenseur des
communautés allemandes excentrées— donne en effet l’ordre de déplacer la
population locale allemande (13.000 habitants) pour offrir le terrain
aux Italiens, en passe d’annexer cette partie de la Slovénie;
simultanément, les partisans communistes slovènes s’emparent de la
région et commencent l’épuration ethnique contre le millier de
germanophones qui avaient décidé de rester, en dépit des ordres de
Berlin. Quand les Italiens s’emparent d’un village tenu par les
partisans, ils le rasent. Quand les partisans chassent les Italiens, ils
font sauter toutes les maisons, désormais vides. On estime à 650 le
nombre de “Gottscheer Deutsche” qui demeureront en Slovénie au lendemain
de la seconde guerre mondiale. Tous contacts avec les “Gottscheer
Deutsche” émigrés (de force) vers l’Allemagne ou l’Autriche sera
formellement interdit par les autorités titistes jusqu’en 1972.
Ni
les Allemands ni les Italiens ni les Slovènes ne tireront bénéfice de
ces confrontations fratricides entre Européens: 80% de la région sont
redevenus forêt. Cette régression est due aussi, explique Gauss (p. 58),
à l’idéologie communiste: aucune famille paysanne, d’aucune nationalité
que ce soit, n’était prête à se retrousser les manches pour redonner
vie au pays, s’il fallait bosser selon les directives d’apparatchiks
ignorants. Pire, le gouvernement titiste-communiste ordonne que la
moitié de la région, désormais désertée, devienne une zone militaire,
d’où les derniers Slovènes sont à leur tour expulsés en 1950. La “vox
populi” chuchote que la nomenklatura avait décrété la militarisation de
cette micro-région, non pas pour des motifs de défense nationale, mais
pour qu’elle soit une réserve de chasse et de pêche exclusive, au
bénéfice des apparatchiks, ou une zone de ramassage des meilleurs
champignons, fins des fins de la gastronomie slovène et carinthienne.
L’ère
titiste est désormais définitivement close. Le projet du nouvel Etat
slovène et des financiers eurocratiques est de transformer la
micro-région, auparavant germanophone, en une zone vouée au tourisme
écologique, aux citadins randonneurs et aisés, aux chasseurs d’ours, aux
amateurs de kayak sur petites rivières à débit rapide. La région ne
retrouvera donc pas son charme d’antan. Après l’effondrement de la
Yougoslavie dans les années 90 du 20ème siècle, la Slovénie
post-communiste organise un sondage qui demande aux habitants du nouvel
Etat à quelle nationalité ils s’identifient: 191 Slovènes se déclareront
de nationalité autrichienne, 546 de nationalité allemande et 1543 se
définiront comme “germanophones”. Ces quelques deux mille Slovènes
germanophones ne sont toutefois pas tous des “Gottscheer Deutsche”, car
la Slovénie abritait d’autres minorités allemandes. La répartition des
“nationalités” effectives —que l’on distinguera du ridicule concept
franco-jacobin de “citoyenneté” (où le citoyen est alors un être
totalement désincarné et sans substance, un être fantômatique et
zombifié, que tous peuvent devenir par simple déclaration, fussent-ils
originaires des antipodes)— est extrêmement complexe dans la région,
explique Gauss: Maribor/Marburg, aujourd’hui en Slovénie, comptait 80%
d’habitants germanophones en 1910, alors que Klagenfurt/Celovec,
aujourd’hui ville autrichienne de Carinthie, comptait bien plus que 20%
de slovénophones à la même époque. En 1991, année du sondage slovène sur
les nationalités effectives du pays, deux associations regroupant les
germanophones de la micro-région de Gottschee se créent pour encadrer
vaille que vaille le reste bien chiche d’une population qui avait compté
environ 70.000 Allemands. Pourtant, la modestie de cette communauté
germanophone résiduaire a fait paniquer les Slovènes qui entrevoyaient
tout à coup le retour offensif des Autrichiens et des Allemands, après
le départ des Fédéraux yougoslaves et des Serbes. Entretemps, 60.000
citoyens des Etats-Unis se déclarent originaires du “Ländchen” de
Gottschee, plus qu’il n’en vivait là-bas, en Slovénie, à l’âge d’or de
cette communauté.
Les Arbëreshe de Calabre
Nous
sommes à 250 km de Naples dans le village de Civita, 1200 habitants,
pour la plupart de souche albanaise. On les appelle les “Arbëreshe”
parce qu’ils ont quitté la région d’Arbënor dans le sud de l’Albanie, il
y a 500 ans. Le village semble peuplé de vieux hommes, revenus au pays
après avoir bossé partout dans le monde, où leur descendance est
dispersée. La Calabre compte une trentaine de villages albanophones,
dont les habitants sont allés travailler en Italie du Nord, en
Allemagne, en Suisse, en Belgique ou en Scandinavie. Au soir de leur
vie, ils reviennent au pays de leurs ancêtres. Ceux-ci sont arrivés en
Italie du Sud en 1468, par bateaux entiers, l’année où leur héros
national, Gjergj Kastriota, alias Skanderbeg, meurt au combat, invaincu,
face aux armées ottomanes. Les réfugiés qui arrivent au 15ème siècle en
Italie sont ceux qui refusent l’ottomanisation et l’islamisation. Ils
repeupleront les villages de Calabre, ravagés par la peste, la guerre,
les séismes. Leur religion est marquée par les formes byzantines que
l’Eglise catholique italienne accepte bon gré mal gré d’abord, sans
réticence ensuite: même un Paul VI, qui a voulu balancer aux orties
toutes les formes traditionnelles, finit par accepter les dérogations
cultuelles accordées aux catholiques albanais de rites byzantins. Les
prêtres catholiques des “Arbëreshe” sont mariés (mais non leurs
évêques); ils donnent du pain et non des hosties à la communion; seule
différence: ils reconnaissent tout simplement l’autorité du Pape romain,
qui protègeait jadis leur nouvelle patrie contre toute offensive
ottomane.
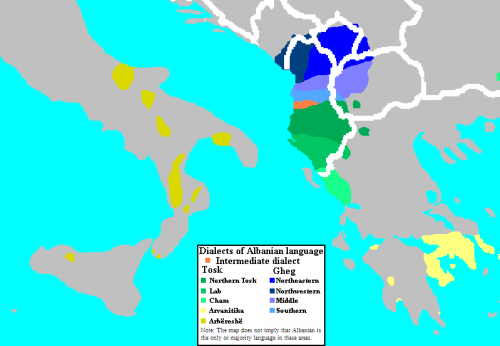
Le
Roi espagnol des Deux-Siciles leur accorde des privilèges en Sicile, en
Calabre, en Apulie et dans le Basilicat où leur mission est de
refertiliser des terres laissées en friche. Sept vagues successives, en
deux cents ans, amèneront un demi million d’Albanais en Italie. Ils sont
venus en même temps que des Grecs, qui, eux aussi, ont gardé leurs
rites orthodoxes, de “Schiavoni” slaves et d’“Epiroti” (d’Epire).
L’ancien royaume des Deux-Siciles était certes majoritairement italien
mais il comptait aussi de fortes minorités italo-albanaises et
italo-grecques, parfaitement intégrées tout en demeurant fidèles à leurs
racines et à leur langue. Dans les troupes de Garibaldi, de nombreux
Italo-Albanais ont combattu vaillament, au point que le nouvel Etat leur
a d’emblée autorisé à créer des écoles où l’on enseignait les deux
langues, l’italien et l’albanais. Les Arbëreshe sont donc des “doubles
patriotes”, écrit Gauss (p. 106): ils sont albanais par la langue,
qu’ils refusent d’oublier, et italiens par patriotisme envers la terre
qui les a accueillis jadis. Dans les armées de Garibaldi et dans celles
de Mussolini, les Albanais de l’ex-royaume des Deux-Siciles ont répondu
“présents”!
Gauss
a rencontré un certain Emanuele Pisarra qui lui a déclaré: “Nous ne
sommes pas les meilleurs des Albanais, nous sommes les vrais Albanais!”
Pourquoi? Parce que le stalinisme d’un Enver Hoxha a malheureusement
transformé les fiers “Shkipetars” d’Albanie en égoïstes indignes,
oublieux de leurs véritables traditions, uniquement soucieux de posséder
une belle auto et une télévision, quitte à s’affilier à un réseau
mafieux. Le stalinisme, pour Pisarra, avait pris le relais d’un islam
ottoman, déjà annihilateur de véritable “albanitude”, de fierté
nationale et d’esprit de liberté. En 1991, quand l’Albanie se dégage de
la cangue communiste et que des bateaux bourrés de réfugiés abordent les
côtes italiennes, Pisarra fut un des premiers à tendre la main à ces
compatriotes d’au-delà de l’Adriatique, à proposer des cours, à chercher
à favoriser leur intégration: il a vite déchanté. Les réfugiés
islamisés et stalinisés ne veulent recevoir aucune formation, n’ont
aucune empathie pour l’histoire de leurs frères albanais d’Italie
méridionale. Ils veulent devenir vite riches dans le paradis
capitaliste. Pire, déplore Pisarra, ils ne parlent plus la belle langue
albanaise que les Arbëreshe ont cultivée pendant cinq siècles en dehors
du pays d’origine: la langue s’est appauvrie et abâtardie. “Ils ont
désormais une autre religion, une autre langue, d’autres valeurs, ils
sont différents”, déplore Pisarra. Ils ne partagent pas la vraie culture
albanaise. A l’exception, sans doute, des “Arvénites” albanophones de
Grèce, qui n’avaient pas traversé la mer au 15ème siècle mais s’étaient
dirigés vers le Sud grec-orthodoxe. Les “Arvénites” orthodoxes de Grèce,
tout comme les “Arbëreshe” catholiques d’Italie, sont atterrés par le
comportement matérialiste de ceux qui quittent l’Albanie ex-communiste
ou le Kosovo pro-atlantiste pour venir embrasser de façon si obscène la
“civilisation du Coca-Cola et du frigidaire de Tokyo à San Francisco”.
La
culture albanaise (la vraie!) connaît cependant une réelle renaissance
en Italie depuis quelques années. D’abord parce que l’Italie accepte ses
propres minorités et promeut le bilinguisme partout où il s’avère de
mise. Pour Gauss, le bilinguisme des minorités constitue, au sein de la
nouvelle culture italienne, une sorte d’avant-garde capable d’être
pleinement et naturellement “diversifiée” et “diversificatrice”, au sens
de ce pluralisme ethnique non politisé qui a toujours fait le charme de
l’Europe, avec des minorités qui passent avec une aisance stupéfiante
d’une langue à l’autre dans les conversations de tous les jours. Le
train de lois votées en Italie en 1999 reconnaît aux Albanais le statut
de minorité, le droit d’enseigner la langue dans les écoles et d’être
servis en “Arbëreshe” dans les services publics. Le temps des
jacobinismes est bel et bien terminé en Italie. Un exemple pour
d’autres!
Les Sorabes d’Allemagne
La
région s’appelle la Lusace. Elle est longue d’une centaine de
kilomètres, à cheval sur les “Länder” du Brandebourg et de la Saxe, à
proximité des frontières polonaise et tchèque. Elle englobe les villes
de Cottbus, Hoyerswerda et Bautzen, et de nombreux villages
pittoresques. Elle est peuplée d’une ethnie slavophone: les Sorabes,
dont le parler est proche du tchèque voire du polonais. Les Sorabes
résiduaires, les plus ancrés dans leurs traditions, sont catholiques
dans un environnement germano-sorabe majoritairement protestant; ils
sont fidèle au culte marial, notamment lors des pèlerinages de
Rosenthal. Tous les Sorabes portent deux noms: un nom allemand (pour
l’état civil), un nom slave (pour la vie quotidienne). Exemples: Lenka
Rjelcec est Elisabeth Rönschke, Jan Mlynk est Hans Müller. C’est comme
ça. Depuis quelques siècles. Et personne ne s’en formalise.
 En
805, les armées de Charlemagne s’ébranlent pour convertir les païens
saxons et slaves (les “Wenden”), les inclure dans l’Empire franc afin
qu’ils paient tribut. Seuls les Sorabes résistent et tiennent bon: de
Magdebourg à Ratisbonne (Regensburg), l’Empereur est contraint d’élever
le “limes sorbicus”. Assez rapidement toutefois, la tribu est absorbée
par le puissant voisin et connaît des fortunes diverses pendant 1200
ans, sans perdre son identité, en dépit des progressistes libéraux du
“Kulturkampf”, qui entendaient éradiquer la “culture réactionnaire” et
des nationaux-socialistes qui suppriment en 1937 tout enseignement en
sorabe et envisagent le déplacement à l’Est, en territoires
exclusivement slaves, de cette “population wende résiduaire” (“Reste des
Wendentums”).
En
805, les armées de Charlemagne s’ébranlent pour convertir les païens
saxons et slaves (les “Wenden”), les inclure dans l’Empire franc afin
qu’ils paient tribut. Seuls les Sorabes résistent et tiennent bon: de
Magdebourg à Ratisbonne (Regensburg), l’Empereur est contraint d’élever
le “limes sorbicus”. Assez rapidement toutefois, la tribu est absorbée
par le puissant voisin et connaît des fortunes diverses pendant 1200
ans, sans perdre son identité, en dépit des progressistes libéraux du
“Kulturkampf”, qui entendaient éradiquer la “culture réactionnaire” et
des nationaux-socialistes qui suppriment en 1937 tout enseignement en
sorabe et envisagent le déplacement à l’Est, en territoires
exclusivement slaves, de cette “population wende résiduaire” (“Reste des
Wendentums”).
Gauss
constate que les éléments sont nombreux qui ont permis à cette identité
sorabe de subsister: la langue, bien sûr, mais aussi les coutumes, les
pèlerinages et les processions (équestres, mariales et pascales), les
costumes traditionnels. Le plus spectaculaire de ces éléments demeure
indubitablement la procession équestre de Pâques, à laquelle des
milliers de Sorabes prennent part. La RDA communiste, slavophile par
inféodation à Moscou, au Comecon et au Pacte de Varsovie, n’a pas
interdit ce folklore et cette “chevauchée pascale” (“Osterritt”), au nom
du matérialisme dialectique et de l’athéisme officiel, mais les chevaux
disponibles s’étaient considérablement raréfiés, vu la collectivisation
du monde agricole. Peu de Sorabes possédaient encore un cheval
personnel. Des coutumes païennes immémoriales ont survécu en
Haute-Lusace, comme celle du “mariage des oiseaux” (“Vogelhochzeit”), où
l’on sacrifie des animaux aux ancêtres avant de les consommmer
collectivement, ou celle de la “décapitation des coqs” (“Hahnrupfen”),
où les garçons doivent décapiter un gallinacé avant de pouvoir danser
avec l’élue de leur coeur sur la place du village. Comme dans les Alpes
et à Bruxelles, les Sorabes plantent aussi l’“Arbre de Mai”. Ce
folklore, marque indélébile de la “culture réactionnaire” des “Wendes
résiduaires”, attire cependant de plus en plus d’Allemands, lassés des
religions officielles anémiées et “modernisées”. Tous, même s’ils
n’allaient plus à l’église ou au temple, y redécouvrent la vraie
religion populaire. La messe ou l’office dominical(e) n’épuise pas la
religion: celle-ci vit bien davantage dans les pèlerinages ou les
processions, expression de la religion vraie et fondamentale, en dépit
du vernis chrétien.
Les
Sorabes ont donc résisté au progressisme du 19ème siècle, au
national-socialisme et à sa politique de germanisation totale, au
communisme de la RDA. La Lusace est le pays de la lignite, matière
première nécessaire à la construction de “la première république
allemande des ouvriers et des paysans”. L’industrialisation forcée,
tablant en partie sur l’exploitation de ces gisements de lignite, devait
englober tout le pays, jusqu’à ses coins les plus reculés. La
collectivisation communiste de la Haute-Lusace s’accompagne de drames,
d’une vague de suicides sans précédent. Les propriétaires de petites
fermes modestes, transmises de père en fils depuis des siècles, se
pendent quand les milices communistes viennent saisir leurs patrimoines
immobiliers pour les inclure dans le système néo-kolkhozien. Ou quand
les camions viennent chercher leurs avoirs pour transplanter leurs
familles dans les clapiers des nouvelles banlieues: le parti a veillé à
tout, ils ont désormais un centre culturel, une salle de sport et des
jardins d’enfants. Mais, ils n’ont plus de terroir, de glèbe. La RDA a
certes donné l’autonomie culturelle à ses citoyens sorabes mais l’exode
forcé hors des villages vers les clapiers d’Hoyerswerda a contribué à
les germaniser avec plus d’efficacité que la politique répressive des
nationaux-socialistes. Quant à la RFA, après la réunification, elle a
reproché aux Sorabes germanisés par les communistes de s’être insurgés
contre le parcage dans leurs villes de vrais ou faux réfugiés politiques
venus d’on ne sait où, pour bénéficier des avantages du système social
allemand. Ces cibles du national-socialisme, soucieux de se débarrasser
enfin des “résidus du ‘Wendentum’”, sont du coup devenus de la graine de
néo-nazis, que l’on fustigeait à qui mieux mieux avec le zèle
hystérique de la prêtraille médiatique!

Résultat:
s’il y avait 200.000 Sorabes recensés au 15ème siècle, et 300 villages
bas-sorabes au 18ème, il n’y a plus aujourd’hui que quelques communes
sorabes autour de Cottbus; elles sont principalement catholiques, les
protestants, majoritaires et moins enclins à pratiquer les rituels
ruraux qui donnent aux traditions sorabes tout leur lustre, ayant été
rapidement germanisés par les pasteurs, qui, souvent, n’acceptaient que
des enfants germanophones pour les préparer à la confirmation.
Les Aroumains de Macédoine
Les
Aroumains sont une ethnie sans terres compactes, dispersée dans une
quantité impressionnnante d’isolats semi-urbains ou ruraux ou dans les
grandes villes des Balkans méridionaux, essentiellement dans l’actuelle
République post-yougoslave de Macédoine. Au départ, ces locuteurs d’une
langue romane proche du roumain avaient pour fonction, dans le Sud de la
péninsule balkanique, d’escorter les caravanes qui pèrégrinaient entre
Venise et Byzance. On évalue leur nombre à un demi-million d’âmes. Seule
la Macédoine les reconnaît comme minorité. Au moyen âge, ce peuple de
marchands et d’intermédiaires était réputé, hautement apprécié: on le
connaissait en Europe du Nord, où ses ressortissants venaient acheter
des marchandises, et son centre névralgique était Moschopolis, une ville
aujourd’hui en ruine, totalement abandonnée, située en Albanie. Ce
peuple porte aussi d’autres noms: le terme français “aroumain” dérive en
droite ligne de l’appelation qu’ils se donnent eux-mêmes, les “armâni”;
les Albanais les nomment “Remeri”, les Grecs, les “Vlaques”, les
Serbes, les “Vlassi”. D’autres noms circulent pour les désigner, comme
les Çobanë, la Macedoneni, les Kutzowlachen ou les “Zinzars”
(Tsintsars). Les communautés aroumaines ne vivent pas en vase clos,
rappelle Gauss, car ils ont participé à tous les mouvements
d’émancipation nationaux-populaires dans les Balkans, depuis les temps
héroïques de la révolte grecque chantée par Lord Byron, qui rencontrera
d’ailleurs bon nombre de “philhellènes” qui étaient en réalité des
Vlaques aroumains. Ne désirant pas perdre tout crédit au sein de cette
population jugée intéressante, le Sultan turc Abdoul Hamid reconnaît
leur nationalité dans un firman de 1905. Cependant, la phase finale des
guerres de libération balkaniques s’achève en 1913, quand la Sublime
Porte doit abandonner toutes ses possessions européennes, sauf la Thrace
entre Andrinople/Edirne et Istanbul. Du coup, les Aroumains sont
répartis sur quatre Etats nouveaux qui veulent absolument faire
coïncider ethnicité et citoyenneté, ce qui n’est possible que par un
alignement inconditionnel et assimilateur sur l’ethnie majoritaire. Les
Bulgares et surtout les Grecs seront les plus sévères à l’égard des
Aroumains: ces locuteurs d’un parler roman qui sont orthodoxes comme les
Roumains auront été finalement mieux reconnus par les Ottomans d’Abdoul
Hamid que par leurs frères orthodoxes, aux côtés desquels ils avaient
combattu les Turcs!
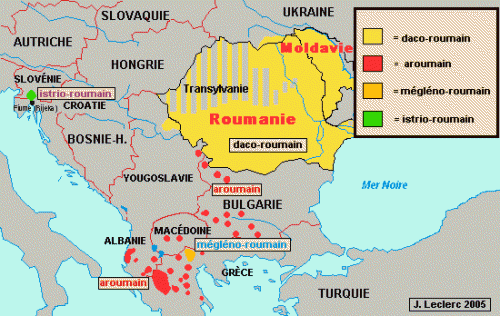
Leurs
revendications actuelles, finalement fort modestes, correspondent tout
simplement à ce qu’Abdoul Hamid était prêt à leur accorder le 20 mai
1905: cette date du 20 mai est devenue celle de la fête nationale de
tous les Aroumains. La déréliction que vivent les Aroumains, sauf en
Macédoine, a fait naître auprès de leurs conteurs une mythologie
nationale grandiose: ils seraient les descendants directs des Pélasges
préhelléniques et Alexandre le Grand aurait été un des leurs. De ce fait
la langue “macédono-aroumaine” n’est pas une forme de néo-latin, née
après la romanisation d’une partie des Balkans et surtout de la Dacie:
elle est bel et bien la langue originelle de la région, à peine mâtinée
de latin d’Italie.
Sur
le plan politique, les Aroumains regrettent l’ère titiste en
Yougoslavie, car le régime les avait autorisés à avoir des associations
culturelles propres. Ils reprochent toutefois à Tito d’avoir été un
communiste car cette idéologie ne leur permettait plus d’exercer leur
fonction traditionnelle de négoce. Aujourd’hui, ils se félicitent des
dispositions bienveillantes que leur accordent les autorités
macédoniennes mais se méfient de l’albanisation croissante de cette
république ex-yougoslave car en Albanie, où les Aroumains sont la
minorité la plus importante, ils ne sont nullement reconnus. Au Kosovo,
nouvel Etat né par la grâce de l’idéologie américaine et
“droit-de-l’hommarde”, les Aroumains sont persécutés par les bandes de
l’UÇK, au même titre que les Serbes ou les Roms. En Macédoine, ils
peuvent à nouveau “aroumainiser” leurs patronymes. Le peintre aroumain
Martin s’est en effet appelé Martinovic en Serbie et Martinov en
Bulgarie, avant de devenir Martinovski en Macédoine. Les Aroumains ont
certes été respectés pour leur savoir-faire et pour leur niveau culturel
élevé mais, dans les Etats ethno-nationaux des Balkans, ils ont
toujours été considérés comme “suspects”: les Albanais les prennent pour
des “Grecs déguisés” cherchant à arracher le Sud de l’Albanie pour la
livrer aux Hellènes. Les Grecs, eux, les considérent comme un reliquat
pré-hellénique au niveau de civilisation fort bas ou comme des “agents
macédoniens”. Les Bulgares les accusent d’être des “Macédoniens
yougoslavistes” refusant de participer à la création d’un “saint royaume
bulgaro-macédonien” englobant une bonne part de l’actuelle République
de Macédoine. Dans le contexte européen actuel, ces suspicions ne sont
évidemment plus de mise.

En
Grèce, la plupart des Aroumains/Vlaques vivent dans un isolat de la
région des Monts Pindos mais sont soumis à une politique d’assimilation
forcenée: le terme qui les désigne, “Vlaque”, est devenu synonyme, en
grec, de “primitif”, d’”homme des bois”, d’”inculte”, d’”idiot”. Cette
propagande négative incessante fait que bon nombre de Vlaques, aussi
pour éviter la déportation vers d’autres régions ou vers des îles arides
de l’Egée, abandonnent leur identité romane, ne la transmettent plus à
leurs enfants, phénomène navrant que l’on a vu se produire ailleurs en
Europe aussi, le jacobinisme français n’ayant pas fait de cadeaux aux
Bretons celtophones, jugés “arriérés” comme Bécassine, le britannisme
anglais ayant également traité les sujets irlandais de leurs rois et
reines de “primitifs” et le système belge ayant considéré parfois sa
majorité (!) flamande de la même manière, au nom d’on ne sait trop
quelle “excellence”. L’ingénieur “grec” Vasile Barba, de souche
aroumaine, lutte pour la survie de son peuple en Allemagne, où il anime
un “Zentrum für aromunische Studien” à Fribourg-en-Brisgau. Il est une
voix très écoutée et très respectée dans les communautés aroumaines
éparses de Grèce, de Bulgarie et de Macédoine.
Le
sort des minorités aroumaines nous permet de formuler quelques
suggestions: 1) la mémoire balkanique ne peut se passer de la mémoire
“aroumaine”, d’autant plus qu’elle est romane au beau milieu d’un monde
slave, hellénique et illyrien-balkanique; cette spécificité doit donc
être protégée; 2) on s’aperçoit que l’immixtion américaine au Kosovo a
déjà fortement ébranlé le patrimoine serbe-orthodoxe, suite aux
vandalisations des monastères et des bibliothèques par les milices
atlanto-wahhabites stipendiées par Washington; le travail de Gauss nous
apprend que les communautés aroumaines, parce qu’orthodoxes, subissent
là-bas le même sort au nom de l’idéologie des droits de l’homme et du
fondamentalisme saoudien. Il est temps, pour les esprits lucides, de
dénoncer, au nom du droit concret des minorités et au nom de la défense
du patrimoine mondial, cette collusion malsaine que les médias véreux
camouflent soigneusement car il est bien entendu que l’Oncle Sam a, pour
ces mercenaires, le droit inaliénable de s’allier avec n’importe qui,
avec n’importe quel ramassis d’iconoclastes, pour pouvoir à terme
disposer de sa grande base au beau milieu de la province serbe du Kosovo
afin de contrôler étroitement l’espace pontique, la péninsule
balkanique, l’Anatolie et le bassin oriental de la Méditerranée (avec le
Canal de Suez).
Robert Steuckers.
(février 2014).
Commentaires
Enregistrer un commentaire