Robert STEUCKERS:
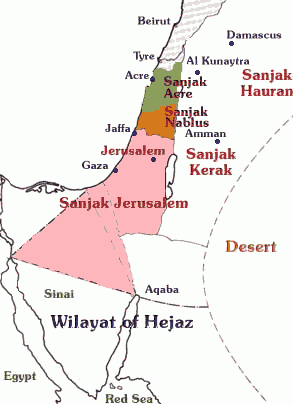 Notre
position ne peut être ni propagandiste ni militante car nous ne sommes
ni juifs ni arabes, car nous ne pouvons raisonnablement nous identifier
aux uns ou aux autres, tout en étant désireux de ne pas voir l’ensemble
du Levant et du Moyen Orient plongé dans une guerre sans fin, qui, dans
tous les cas de figure, serait contraire à nos intérêts. Le sionisme,
c’est-à-dire la volonté de transplanter tous les juifs d’Europe dans
l’ancienne Palestine romaine ou ottomane, n’a pourtant pas, au départ,
des origines juives. Le tout premier à avoir émis l’hypothèse d’une
telle transplantation est mon compatriote, le Feldmarschall impérial
Charles-Joseph de Ligne, envoyé comme attaché militaire autrichien
auprès de Catherine II la Grande en guerre contre l’Empire ottoman,
auquel elle arrachera la Crimée, sanctionnant ainsi la prépondérance
russe en Mer Noire. A cette époque qui a immédiatement précédé les
délires criminels de la révolution française, Russes et Autrichiens
envisageaient de porter un coup final à cet empire moribond qui avait
assiégé l’Europe du Sud-Est pendant plusieurs siècles. Pour y parvenir,
le Prince de Ligne a suggéré d’envoyer toute la population des ghettos
d’Europe centrale et orientale dans la partie médiane de l’Empire
ottoman, de façon à ce qu’un foyer de dissidence se crée, au bénéfice
des Russes et des Autrichiens, entre l’Egypte, province de la Sublime
Porte, et l’Anatolie proprement turque. L’objectif de ce “sionisme” ante litteram,
non idéologique et non religieux mais essentiellement tactique, était
donc de séparer l’Egypte de la masse territoriale anatolienne, sur un
territoire, qui, dans l’histoire antique, avait déjà été âprement
disputé entre les Pharaons et les souverains hittites (bataille de
Qadesh) voire, aux temps des Croisades européennes, entre Fatimides
d’Egypte, alliés occasionnels des rois croisés, et Seldjouks.
Notre
position ne peut être ni propagandiste ni militante car nous ne sommes
ni juifs ni arabes, car nous ne pouvons raisonnablement nous identifier
aux uns ou aux autres, tout en étant désireux de ne pas voir l’ensemble
du Levant et du Moyen Orient plongé dans une guerre sans fin, qui, dans
tous les cas de figure, serait contraire à nos intérêts. Le sionisme,
c’est-à-dire la volonté de transplanter tous les juifs d’Europe dans
l’ancienne Palestine romaine ou ottomane, n’a pourtant pas, au départ,
des origines juives. Le tout premier à avoir émis l’hypothèse d’une
telle transplantation est mon compatriote, le Feldmarschall impérial
Charles-Joseph de Ligne, envoyé comme attaché militaire autrichien
auprès de Catherine II la Grande en guerre contre l’Empire ottoman,
auquel elle arrachera la Crimée, sanctionnant ainsi la prépondérance
russe en Mer Noire. A cette époque qui a immédiatement précédé les
délires criminels de la révolution française, Russes et Autrichiens
envisageaient de porter un coup final à cet empire moribond qui avait
assiégé l’Europe du Sud-Est pendant plusieurs siècles. Pour y parvenir,
le Prince de Ligne a suggéré d’envoyer toute la population des ghettos
d’Europe centrale et orientale dans la partie médiane de l’Empire
ottoman, de façon à ce qu’un foyer de dissidence se crée, au bénéfice
des Russes et des Autrichiens, entre l’Egypte, province de la Sublime
Porte, et l’Anatolie proprement turque. L’objectif de ce “sionisme” ante litteram,
non idéologique et non religieux mais essentiellement tactique, était
donc de séparer l’Egypte de la masse territoriale anatolienne, sur un
territoire, qui, dans l’histoire antique, avait déjà été âprement
disputé entre les Pharaons et les souverains hittites (bataille de
Qadesh) voire, aux temps des Croisades européennes, entre Fatimides
d’Egypte, alliés occasionnels des rois croisés, et Seldjouks.

Après la guerre “inter-ottomane” entre le Sultan et Mehmet Ali, en 1847, Abdel Khader capitule et se rend aux Français en Algérie, pays auquel il avait voulu rendre l’indépendance. Le Duc d’Aumale, vainqueur, lui accorde sa garantie et sa protection. Il croupit d’abord dans une prison française de 1848 à 1852 puis s’exile à Damas en Syrie en 1853. Il est autorisé à y séjourner avec sa suite, une troupe d’un millier de soldats maghrébins aguerris, avec leur famille. Cette émigration hors de l’Algérie devenue française permet au Second Empire de se débarrasser des éléments les plus turbulents de la première révolte algérienne et, comme nous le verrons, d’exploiter leur dynamisme et leur fougue guerrière. Les Ottomans ne contestent pas cette présence: ils ont besoin de leurs nouveaux alliés français contre la Russie qui a attaqué les ports turcs de la Mer Noire, déclenchant ainsi la Guerre de Crimée. En 1860, après cette guerre qui a ruiné les principes pan-européens (et eurasistes avant la lettre) de la Sainte-Alliance, des troubles éclatent au Liban et dans le Djebel druze, où la population locale musulmane ou druze massacre les chrétiens, obligeant la France, protectrice de jure de ces minorités chrétiennes dans l’Empire ottoman, à intervenir. Abdel Khader, devenu instrument militaire de la France avec son armée algérienne installée en Syrie, intervient et sauve les chrétiens syriens du massacre. Ces troubles du Levant avaient éclaté parce que le Sultan avait envisagé d’accorder aux puissances européennes, surtout la France et l’Angleterre, toutes sortes de concessions, notamment celles qui consistait à lever le statut de dhimmitude pour les chrétiens d’Orient et à autoriser les puissances chrétiennes à ouvrir des écoles dans tous les vilayets entre Antioche et le Sinaï. La politique occidentale, franco-anglaise, n’est plus, alors, de créer un Etat-tampon juif mais de créer une nation arabe moderne, favorable à l’Occident, en rébellion contre la Sublime Porte, formant un verrou grand-syrien cohérent entre l’Egypte et l’Anatolie. Dans ce projet, la France et l’Angleterre visent surtout à asseoir leur domination sur le Liban actuel, où on fabriquera, grâce aux nouvelles écoles catholiques ou protestantes, une élite intellectuelle occidentalisée, au départ de groupes de Maronites nationalistes arabes, hostiles à la Sublime Porte, qui ne les avait pas protégés en 1860 dans le Djebel druze.
L’idée sioniste est alors quasiment absente dans les ghettos juifs d’Europe, a fortiori au sein des judaïsmes émancipés dont les représentants n’ont nulle envie d’aller cultiver la terre ingrate du Levant. On peut cependant citer des prédécesseurs religieux, dont le rabbin de Sarajevo Alkalai (1798-1878), sujet ottoman, qui énonce, non pas l ‘idée d’aller s’installer en Palestine, mais une idée neuve et révolutionnaire au sein du judaïsme européen: le judaïsme ne doit plus être la religion qui attend en toute quiétude que revienne le Messie. Pour Alkalai, il ne faut plus attendre, il faut se libérer activement et le Messie viendra. Pour développer une action, il faut un projet, qu’Alkalai n’énonce pas encore mais son refus de l’attitude d’attente de la religion mosaïque traditionnelle implique ipso facto de sortir de sa quiétude impolitique, de se porter vers un activisme qui attend son heure et ses mots d’ordre. Par ailleurs, à Thorn en Posnanie prussienne, Zvi Hirsch Kalisher (1795-1874) propose, pragmatique à rebours de son collègue de Sarajevo, la création d’une société de colonisation en 1861-62. C’est le premier projet “sioniste” juif non purement tactique, émanant d’une géopolitique française, russe ou autrichienne. On notera que ces projets constituent une réaction contre l’émancipation (qui, disent ces pré-sionistes, va aliéner les juifs par rapport à leur héritage ancestral) et non contre les persécutions. Leur attitude est dès lors assez ambigüe: il faut rester juif mais non pas à la mode traditionnelle et “quiète”; il faut le rester en pratiquant un nouvel activisme qui, dans ses principes, serait juif, non transmissible aux non-juifs, mais simultanément non traditionnel, ce qui conduit les traditionalistes quiets à rétorquer qu’un activisme ne peut être juif, mais seulement copie maladroite des manies des “goyim” et que seul l’attente est signe de judaïsme véritable.

Le socialiste allemand de confession juive Moïse (Moshe) Hess, issu de l’écurie des Jeunes Hégéliens comme Karl Marx (avec qui il se disputera), observe, après 1848, l’agitation politique que suscitent les mouvements nationaux partout en Europe, surtout en Italie, en Pologne et dans les Balkans. Il voyait la faiblesse du judaïsme dans son particularisme, face à un christianisme qui se voulait universel (positions assez différentes de celles, bricolées, d’un Bernard-Henri Lévy qui, lui, voit des peuples goyim indécrottablement “particularistes” ou “vernaculaires” et un judaïsme essentiellement universaliste). Errant dans un espace idéologique sans limites perceptibles, dans un flou conceptuel, le socialisme de Hess l’induit d’abord à lutter pour l’émancipation du prolétariat, indépendamment de toute appartenance religieuse. Plus tard, il revient au judaïsme, noyau religieux de la “nationalité juive”, et réclame le droit des juifs à avoir un Etat à eux puisque personne ne veut les assimiler, les accepter. Il en déduit que les juifs sont inassimilables et que cette “inassimilabilité” —qu’il juge finalement positive— caractérise leur nationalité, en même temps que leur particularisme. Par conséquent, il pense que la France, qui a défendu les Maronites de Syrie contre les Druzes avec l’aide des guerriers d’Abdel Khader, pourrait aider les juifs d’Europe à se créer un foyer au Levant qui, en même temps, serait un modèle de société socialiste et égalitaire. Il n’est pas pris au sérieux par la majorité de ses co-religionnaires d’Europe occidentale et centrale qui le prennent pour un utopiste (exactement comme Marx!).
 Jusqu’à la parution du petit livre de Théodore Herzl en février 1896, intitulé L’Etat juif,
le sionisme est une idéologie vague et confuse, affirmée puis
critiquée, acceptée puis reniée. Le livre de Herzl n’était pas moins
confus car il ne disait rien de précis sur le site géographique de ce
futur et très hypothétique “Etat juif”. Il pourrait se situer en
Palestine mais aussi ailleurs dans le monde. Son manifeste, bien que
confus, attire quelques personnalités influentes (Nordau, Kahn, Lazare,
Goldschmidt, Montagu, etc.) et recueille les signatures de milliers
d’étudiants juifs d’Europe centrale. Mais les assimilationistes et les
quelques colons de Palestine (issus du mouvement ‘Hovevei Zion) ne le
soutiennent pas, parce qu’ils craignent d’éveiller un nouvel
antisémitisme ou de voir les frontières des vilayets ottomans du Levant
se fermer à tous nouveaux arrivants par crainte d’une submersion. Herzl
développe alors une véritable “diplomatie sioniste” tous azimuts pour
tenter, vaille que vaille, d’arriver à ses fins, avec l’appui, non pas
d’une bourgeoisie juive assimilationiste, mais de dizaines de milliers
de petites gens qui n’ont guère d’espoir d’avancer socialement, surtout
en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette agitation autour de Herzl
va, suite au “Congrès de Bâle” d’août 1897, donner naissance au sionisme
moderne, autonome, capable, théoriquement, de faire avancer ses idées
sans le soutien d’une puissance impériale. Guillaume II d’Allemagne, qui
n’est certainement pas antisémite, décourage cette volonté romantique
de faire l’alya
(le retour à la Terre de Sion) pour ne pas heurter son nouvel allié
turc. Les Russes, qui auraient pu pratiquer à leur profit la politique
jadis préconisée par le Prince de Ligne ou Napoléon, répugnent à le
faire. Le rêve sioniste de Herzl ne pourra cependant pas se concrétiser
sans la “Déclaration Balfour” de 1917 qui donnera le coup d’envoi à la
colonisation massive des terres de Palestine par des colons juifs venus
d’Europe après la première guerre mondiale, surtout de Russie (ceux qui
refusaient la bolchevisation de l’Empire des Tsars comme Jabotinsky) et
d’Europe centrale, après les réactions hongroises et roumaines contre le
régime “judéo-bolchevique” de Belà Kun à Budapest.
Jusqu’à la parution du petit livre de Théodore Herzl en février 1896, intitulé L’Etat juif,
le sionisme est une idéologie vague et confuse, affirmée puis
critiquée, acceptée puis reniée. Le livre de Herzl n’était pas moins
confus car il ne disait rien de précis sur le site géographique de ce
futur et très hypothétique “Etat juif”. Il pourrait se situer en
Palestine mais aussi ailleurs dans le monde. Son manifeste, bien que
confus, attire quelques personnalités influentes (Nordau, Kahn, Lazare,
Goldschmidt, Montagu, etc.) et recueille les signatures de milliers
d’étudiants juifs d’Europe centrale. Mais les assimilationistes et les
quelques colons de Palestine (issus du mouvement ‘Hovevei Zion) ne le
soutiennent pas, parce qu’ils craignent d’éveiller un nouvel
antisémitisme ou de voir les frontières des vilayets ottomans du Levant
se fermer à tous nouveaux arrivants par crainte d’une submersion. Herzl
développe alors une véritable “diplomatie sioniste” tous azimuts pour
tenter, vaille que vaille, d’arriver à ses fins, avec l’appui, non pas
d’une bourgeoisie juive assimilationiste, mais de dizaines de milliers
de petites gens qui n’ont guère d’espoir d’avancer socialement, surtout
en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette agitation autour de Herzl
va, suite au “Congrès de Bâle” d’août 1897, donner naissance au sionisme
moderne, autonome, capable, théoriquement, de faire avancer ses idées
sans le soutien d’une puissance impériale. Guillaume II d’Allemagne, qui
n’est certainement pas antisémite, décourage cette volonté romantique
de faire l’alya
(le retour à la Terre de Sion) pour ne pas heurter son nouvel allié
turc. Les Russes, qui auraient pu pratiquer à leur profit la politique
jadis préconisée par le Prince de Ligne ou Napoléon, répugnent à le
faire. Le rêve sioniste de Herzl ne pourra cependant pas se concrétiser
sans la “Déclaration Balfour” de 1917 qui donnera le coup d’envoi à la
colonisation massive des terres de Palestine par des colons juifs venus
d’Europe après la première guerre mondiale, surtout de Russie (ceux qui
refusaient la bolchevisation de l’Empire des Tsars comme Jabotinsky) et
d’Europe centrale, après les réactions hongroises et roumaines contre le
régime “judéo-bolchevique” de Belà Kun à Budapest.
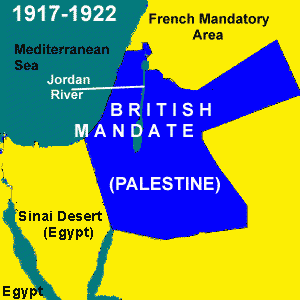
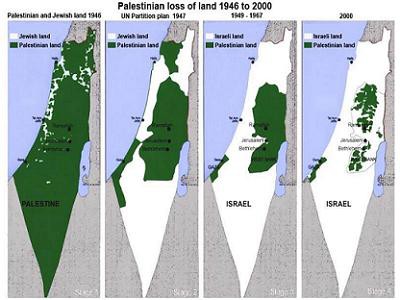
Aux sources de l’idéologie sioniste
Extrait d’une conférence sur le Proche Orient, prononcée à la tribune du “Cercle Proudhon” à Genève, avril 2010
Le
sionisme suscite l’enthousiasme dans une bonne part de la communauté
juive, tous pays confondus, chez les “chrétiens sionistes” américains,
qui sont des fondamentalistes protestants, et chez les occidentalistes
et les atlantistes de toutes obédiences (de gauche comme de droite). En
revanche, pour beaucoup d’autres, et a fortiori
dans les pays arabes et les communautés arabo-musulmanes immigrées dans
les pays occidentaux, le sionisme est considérée comme une forme de
racisme juif dont les victimes sont les Arabes de Palestine. Une vive
passion s’est emparée de toutes les discussions relatives à cette
question, tant et si bien que les parties prenantes de ce débat ont une
vision généralement propagandiste et militante sur le fait sioniste,
oublieuse, comme toutes les autres visions propagandistes et militantes,
des racines historiques du complexe d’idées qu’elles exaltent ou
qu’elles vouent aux gémonies. L’esprit partisan est toujours rétif aux
démarches généalogiques. Il répète à satiété ses “ritournelles”, sans
tenir compte ni du réel ni du passé.
Le Prince de Ligne et Napoléon
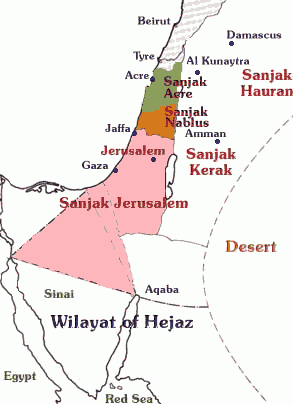 Notre
position ne peut être ni propagandiste ni militante car nous ne sommes
ni juifs ni arabes, car nous ne pouvons raisonnablement nous identifier
aux uns ou aux autres, tout en étant désireux de ne pas voir l’ensemble
du Levant et du Moyen Orient plongé dans une guerre sans fin, qui, dans
tous les cas de figure, serait contraire à nos intérêts. Le sionisme,
c’est-à-dire la volonté de transplanter tous les juifs d’Europe dans
l’ancienne Palestine romaine ou ottomane, n’a pourtant pas, au départ,
des origines juives. Le tout premier à avoir émis l’hypothèse d’une
telle transplantation est mon compatriote, le Feldmarschall impérial
Charles-Joseph de Ligne, envoyé comme attaché militaire autrichien
auprès de Catherine II la Grande en guerre contre l’Empire ottoman,
auquel elle arrachera la Crimée, sanctionnant ainsi la prépondérance
russe en Mer Noire. A cette époque qui a immédiatement précédé les
délires criminels de la révolution française, Russes et Autrichiens
envisageaient de porter un coup final à cet empire moribond qui avait
assiégé l’Europe du Sud-Est pendant plusieurs siècles. Pour y parvenir,
le Prince de Ligne a suggéré d’envoyer toute la population des ghettos
d’Europe centrale et orientale dans la partie médiane de l’Empire
ottoman, de façon à ce qu’un foyer de dissidence se crée, au bénéfice
des Russes et des Autrichiens, entre l’Egypte, province de la Sublime
Porte, et l’Anatolie proprement turque. L’objectif de ce “sionisme” ante litteram,
non idéologique et non religieux mais essentiellement tactique, était
donc de séparer l’Egypte de la masse territoriale anatolienne, sur un
territoire, qui, dans l’histoire antique, avait déjà été âprement
disputé entre les Pharaons et les souverains hittites (bataille de
Qadesh) voire, aux temps des Croisades européennes, entre Fatimides
d’Egypte, alliés occasionnels des rois croisés, et Seldjouks.
Notre
position ne peut être ni propagandiste ni militante car nous ne sommes
ni juifs ni arabes, car nous ne pouvons raisonnablement nous identifier
aux uns ou aux autres, tout en étant désireux de ne pas voir l’ensemble
du Levant et du Moyen Orient plongé dans une guerre sans fin, qui, dans
tous les cas de figure, serait contraire à nos intérêts. Le sionisme,
c’est-à-dire la volonté de transplanter tous les juifs d’Europe dans
l’ancienne Palestine romaine ou ottomane, n’a pourtant pas, au départ,
des origines juives. Le tout premier à avoir émis l’hypothèse d’une
telle transplantation est mon compatriote, le Feldmarschall impérial
Charles-Joseph de Ligne, envoyé comme attaché militaire autrichien
auprès de Catherine II la Grande en guerre contre l’Empire ottoman,
auquel elle arrachera la Crimée, sanctionnant ainsi la prépondérance
russe en Mer Noire. A cette époque qui a immédiatement précédé les
délires criminels de la révolution française, Russes et Autrichiens
envisageaient de porter un coup final à cet empire moribond qui avait
assiégé l’Europe du Sud-Est pendant plusieurs siècles. Pour y parvenir,
le Prince de Ligne a suggéré d’envoyer toute la population des ghettos
d’Europe centrale et orientale dans la partie médiane de l’Empire
ottoman, de façon à ce qu’un foyer de dissidence se crée, au bénéfice
des Russes et des Autrichiens, entre l’Egypte, province de la Sublime
Porte, et l’Anatolie proprement turque. L’objectif de ce “sionisme” ante litteram,
non idéologique et non religieux mais essentiellement tactique, était
donc de séparer l’Egypte de la masse territoriale anatolienne, sur un
territoire, qui, dans l’histoire antique, avait déjà été âprement
disputé entre les Pharaons et les souverains hittites (bataille de
Qadesh) voire, aux temps des Croisades européennes, entre Fatimides
d’Egypte, alliés occasionnels des rois croisés, et Seldjouks.
La
révolution française, fomentée par Pitt pour venger la défaite de la
flotte anglaise à Yorktown en 1783 lors de la guerre d’indépendance des
Etats-Unis, va distraire Russes et surtout Autrichiens de la tâche
géopolitique naturelle qu’ils s’étaient assignée: parfaire la libération
de l’Europe balkanique, hellénique et pontique afin de conjurer
définitivement la menace ottomane. Napoléon Bonaparte, fervent lecteur
des lettres galantes et coquines du Prince de Ligne, reprendra l’idée à
son compte, sans pouvoir la réaliser, sa campagne d’Egypte s’étant
soldée par un fiasco total avec la défaite navale d’Aboukir. En occupant
provisoirement l’Egypte, Bonaparte s’oppose à l’Empire ottoman, déjà
considérablement affaibli par les coups que lui avaient portés les
armées russes et autrichiennes près d’une vingtaine d’années auparavant.
Les visées françaises sur l’Egypte obligent, d’une part, les Anglais à
soutenir les Ottomans (aussi contre les Russes qui font pression sur les
Détroits) et, d’autre part, Napoléon à envisager de créer une sorte
d’Etat-tampon juif francophile entre une future Egypte tournée vers la
France et la masse territoriale anatolienne et balkanique, d’où étaient
généralement issus les meilleurs soldats ottomans, dont les pugnaces
janissaires et leurs successeurs. L’enclave juive devait servir à
protéger le futur Canal de Suez encore à creuser et les richesses du
Nil, notamment les cultures du coton, richesse convoitée par la France
révolutionnaire. Le militant sioniste de droite Jabotinski, ancêtre
intellectuel des droites israéliennes, faisait directement référence à
ces projets napoléoniens dans ses écrits militants, marqués par des
linéaments idéologiques bonapartistes, garibaldistes et... mussoliniens.
Mais les projets du Prince de Ligne et de Bonaparte resteront lettre
morte. Ce sionisme non juif et purement tactique sera oublié pendant
plusieurs décennies après la défaite napoléonienne à Waterloo et les
dispositions prises lors du Traité de Vienne.
Lord Shaftesbury
Le
projet sera réexhumé dès la fin des années 30 du 19ème siècle quand
l’Empire ottoman sera déchiré par une guerre interne, opposant le Sultan
d’Istanbul, soutenu par l’Angleterre, et Mehmet Ali, d’origine
albanaise, khédive d’Egypte appuyé par la France. A Londres, Lord
Shaftesbury relance l’idée dans les colonnes de la revue Globe et dans un article du Times (17
août 1840); il réclame dans ces publications “a land without a people
for a people without a land” (“une terre sans peuple pour un peuple sans
terre”), esquissant un plan, qui, finalement, se concrétisera un peu
plus d’un siècle plus tard, lors de la création de l’Etat d’Israël. Le
père du “sionisme”, qui n’a pas encore de nom, est donc un lord
conservateur anglais. Outre le fait qu’il émet l’idée fausse d’une
Palestine vide, prête à accueillir une population errante en Europe et
jugée indésirable, Lord Shaftesbury préconise dans son article la
création d’un Etat indépendant en Syrie-Palestine ouvert à la
colonisation juive (et donc non entièrement juif), un Etat qui fera
tampon entre l’Egypte et la Turquie, projet où l’Angleterre aura le beau
rôle du “nouveau Cyrus” qui ramènera les juifs en Palestine. Disraëli,
d’origine juive, relance à son tour l’idée en lui donnant une
connotation plus romantique, un peu dans le style du “philhellénisme” de
Lord Byron, autre figure tragique et originale anglaise qui a permis à
Londres d’intervenir dans le bassin oriental de la Méditerranée. Mais
l’idée “pré-sioniste” est très vite abandonnée après la Guerre de Crimée
où la France et l’Angleterre s’allient à l’Empire ottoman contre la
Russie, afin de la contenir au nord du Bosphore. L’Angleterre devient la
protectrice de l’Empire ottoman, le soutient à fond lors de la guerre
russo-turque de 1877-78 tout en occupant Chypre et en étendant sa
protection à l’Egypte en 1882: Albion ne fait rien pour rien! Dans un
tel contexte, il est donc bien inutile de fabriquer un Etat-tampon entre
deux entités d’un même empire dont on est l’allié ou dont on “protège”
le fleuron. On ne ressortira l’idée sioniste du placard que lorsque
l’Empire ottoman s’alignera progressivement sur l’Allemagne de Guillaume
II, faute d’une politique cohérente de ses alliés français et anglais,
qui ont d’abord protégé la Sublime Porte contre la Russie, entre 1853 et
1856 (Guerre de Crimée) et en 1877-78, quand Russes, Bulgares et
Roumains envahissaient les possessions balkaniques du Sultan, tout en
menaçant Constantinople. La politique franco-anglaise était marquée par
la duplicité: les alliés occidnetaux avaient deux fers au feu: protéger
l’Empire ottoman moribond, tout en le dépouillant de ses territoires les
plus stratégiques; imaginer une politique de dislocation de ce même
Empire ottoman, en pariant sur l’éventuelle royauté d’Abdel Khader au
Levant ou en créant une élite arabe pro-occidentale au Liban et en Syrie
(cf. infra), pour affaiblir le nouvel allié du Kaiser allemand.

Abdel Khader
Après la guerre “inter-ottomane” entre le Sultan et Mehmet Ali, en 1847, Abdel Khader capitule et se rend aux Français en Algérie, pays auquel il avait voulu rendre l’indépendance. Le Duc d’Aumale, vainqueur, lui accorde sa garantie et sa protection. Il croupit d’abord dans une prison française de 1848 à 1852 puis s’exile à Damas en Syrie en 1853. Il est autorisé à y séjourner avec sa suite, une troupe d’un millier de soldats maghrébins aguerris, avec leur famille. Cette émigration hors de l’Algérie devenue française permet au Second Empire de se débarrasser des éléments les plus turbulents de la première révolte algérienne et, comme nous le verrons, d’exploiter leur dynamisme et leur fougue guerrière. Les Ottomans ne contestent pas cette présence: ils ont besoin de leurs nouveaux alliés français contre la Russie qui a attaqué les ports turcs de la Mer Noire, déclenchant ainsi la Guerre de Crimée. En 1860, après cette guerre qui a ruiné les principes pan-européens (et eurasistes avant la lettre) de la Sainte-Alliance, des troubles éclatent au Liban et dans le Djebel druze, où la population locale musulmane ou druze massacre les chrétiens, obligeant la France, protectrice de jure de ces minorités chrétiennes dans l’Empire ottoman, à intervenir. Abdel Khader, devenu instrument militaire de la France avec son armée algérienne installée en Syrie, intervient et sauve les chrétiens syriens du massacre. Ces troubles du Levant avaient éclaté parce que le Sultan avait envisagé d’accorder aux puissances européennes, surtout la France et l’Angleterre, toutes sortes de concessions, notamment celles qui consistait à lever le statut de dhimmitude pour les chrétiens d’Orient et à autoriser les puissances chrétiennes à ouvrir des écoles dans tous les vilayets entre Antioche et le Sinaï. La politique occidentale, franco-anglaise, n’est plus, alors, de créer un Etat-tampon juif mais de créer une nation arabe moderne, favorable à l’Occident, en rébellion contre la Sublime Porte, formant un verrou grand-syrien cohérent entre l’Egypte et l’Anatolie. Dans ce projet, la France et l’Angleterre visent surtout à asseoir leur domination sur le Liban actuel, où on fabriquera, grâce aux nouvelles écoles catholiques ou protestantes, une élite intellectuelle occidentalisée, au départ de groupes de Maronites nationalistes arabes, hostiles à la Sublime Porte, qui ne les avait pas protégés en 1860 dans le Djebel druze.
En
1876, Abdülhamid monte sur le trône ottoman. En 1877-78, ses armées
sont écrasées par les Russes qui volent au secours des Bulgares et des
Roumains qui venaient de proclamer leur indépendance. Les territoires
balkaniques de l’Empire ottoman se réduisent comme une peau de chagrin,
entraînant une crise générale dans tout l’Empire. Il est fragilisé à
l’extrême: les Bulgares ont campé devant les murs de Constantinople et
sont désormais en mesure de réitérer cette aventure militaire avec
l’appui russe. La Turquie ottomane se tourne de plus en plus vers
l’Allemagne, tandis que les Français rêvent d’un royaume arabe du
Levant, dont le souverain serait... Abdel Khader. On ne songe plus à
envoyer dans la région les juifs d’Europe.
Rabbi Alkalai, Zvi Hirsch Kalisher, Joseph Natonek
L’idée sioniste est alors quasiment absente dans les ghettos juifs d’Europe, a fortiori au sein des judaïsmes émancipés dont les représentants n’ont nulle envie d’aller cultiver la terre ingrate du Levant. On peut cependant citer des prédécesseurs religieux, dont le rabbin de Sarajevo Alkalai (1798-1878), sujet ottoman, qui énonce, non pas l ‘idée d’aller s’installer en Palestine, mais une idée neuve et révolutionnaire au sein du judaïsme européen: le judaïsme ne doit plus être la religion qui attend en toute quiétude que revienne le Messie. Pour Alkalai, il ne faut plus attendre, il faut se libérer activement et le Messie viendra. Pour développer une action, il faut un projet, qu’Alkalai n’énonce pas encore mais son refus de l’attitude d’attente de la religion mosaïque traditionnelle implique ipso facto de sortir de sa quiétude impolitique, de se porter vers un activisme qui attend son heure et ses mots d’ordre. Par ailleurs, à Thorn en Posnanie prussienne, Zvi Hirsch Kalisher (1795-1874) propose, pragmatique à rebours de son collègue de Sarajevo, la création d’une société de colonisation en 1861-62. C’est le premier projet “sioniste” juif non purement tactique, émanant d’une géopolitique française, russe ou autrichienne. On notera que ces projets constituent une réaction contre l’émancipation (qui, disent ces pré-sionistes, va aliéner les juifs par rapport à leur héritage ancestral) et non contre les persécutions. Leur attitude est dès lors assez ambigüe: il faut rester juif mais non pas à la mode traditionnelle et “quiète”; il faut le rester en pratiquant un nouvel activisme qui, dans ses principes, serait juif, non transmissible aux non-juifs, mais simultanément non traditionnel, ce qui conduit les traditionalistes quiets à rétorquer qu’un activisme ne peut être juif, mais seulement copie maladroite des manies des “goyim” et que seul l’attente est signe de judaïsme véritable.
Un
peu plus tard, Joseph Natonek (1813-1892) élabore un plan plus précis,
celui que reprendra Herzl et son fameux “Congrès sioniste” de 1897.
Natonek suggère la création d’un “Congrès juif mondial”, de demander
ensuite une charte aux Turcs, d’amorcer une colonisation agricole puis
de favoriser une émigration de masse vers la Palestine et de créer une
langue hébraïque moderne. Natonek ne donne pas de nom à son projet: on
ne peut pas parler de sionisme, puisque le terme n’existe pas encore.
Personne ne suit Natonek: l’alliance israélite universelle refuse ses
plans en 1866 et se borne à aider, via des initiatives philanthropiques,
les juifs ottomans de Palestine, ceux du “vieux peuplement” ou “vieux
yishuv”. Natonek, dépité, se retire de tous les débats que ses idées
avaient lancés. Deux membres de sa famille partent en Palestine pour
fonder une colonie agricole, la toute première de l’histoire du
sionisme.

Moïse Hess
Le socialiste allemand de confession juive Moïse (Moshe) Hess, issu de l’écurie des Jeunes Hégéliens comme Karl Marx (avec qui il se disputera), observe, après 1848, l’agitation politique que suscitent les mouvements nationaux partout en Europe, surtout en Italie, en Pologne et dans les Balkans. Il voyait la faiblesse du judaïsme dans son particularisme, face à un christianisme qui se voulait universel (positions assez différentes de celles, bricolées, d’un Bernard-Henri Lévy qui, lui, voit des peuples goyim indécrottablement “particularistes” ou “vernaculaires” et un judaïsme essentiellement universaliste). Errant dans un espace idéologique sans limites perceptibles, dans un flou conceptuel, le socialisme de Hess l’induit d’abord à lutter pour l’émancipation du prolétariat, indépendamment de toute appartenance religieuse. Plus tard, il revient au judaïsme, noyau religieux de la “nationalité juive”, et réclame le droit des juifs à avoir un Etat à eux puisque personne ne veut les assimiler, les accepter. Il en déduit que les juifs sont inassimilables et que cette “inassimilabilité” —qu’il juge finalement positive— caractérise leur nationalité, en même temps que leur particularisme. Par conséquent, il pense que la France, qui a défendu les Maronites de Syrie contre les Druzes avec l’aide des guerriers d’Abdel Khader, pourrait aider les juifs d’Europe à se créer un foyer au Levant qui, en même temps, serait un modèle de société socialiste et égalitaire. Il n’est pas pris au sérieux par la majorité de ses co-religionnaires d’Europe occidentale et centrale qui le prennent pour un utopiste (exactement comme Marx!).
Leo Pinsker
Avant
le manifeste de Theodor Herzl, qui lancera le sionisme proprement dit,
une idée motrice émerge dans le monde intellectuel juif, chez un certain
Leo Pinsker: celui-ci préconise un “retour à la normalité”. Il
argumente: c’est parce que les juifs ne sont pas “normaux” qu’il y a de
l’antisémitisme. Si les juifs revenaient à une “normalité” qu’ils
partageraient avec les autres citoyens des Etats dans lesquels ils
vivent, l’antisémitisme n’aurait plus raison d’être. Or l’antisémitisme
devenait virulent en Europe orientale: les pogroms se succèdaient en
Russie et la Roumanie, devenue indépendante, ne reconnaissait pas les
juifs comme citoyens; de même, les émeutes et les pillages antijuifs,
commis par les Européens de souche et les autochtones arabo-berbères en
Algérie française se multiplient dans les années 90 du 19ème siècle.
L’idée sioniste, avant la lettre, trouvera par conséquent un large écho
en Roumanie. Parmi les tout premiers immigrants juifs du “nouveau
yishuv”, on comptait beaucoup de ressortissants des ghettos de Roumanie,
mal accueillis par leurs coreligionnaires du “vieux yishuv”. Quant aux
juifs de Russie, la route de l’immigration leur est barrée en 1893 par
ordre du Sultan, qui craint que les Russes appliquent l’idée purement
tactique du Prince de Ligne et de Napoléon, en créant, par l’envoi
massif de juifs de Russie, un judaïsme fidèle à l’ennemi slave sur le
flanc sud de l’Anatolie turque. Par la volonté du Sultan, les juifs
russes ne peuvent donc plus acheter de terres en Palestine. En 1890,
Nathan Birnbaum forge le mot de “sionisme” dans la revue Kadima,
en faisant référence à la colline de Sion à Jérusalem. Mais Birnbaum
abandonne bien vite l’idée sioniste: il plaidera pour l’éclosion de
“judaïsmes nationaux”, notamment en Allemagne, dont la langue serait le
yiddisch et non pas un “nouvel hébreu” comme l’avait demandé Natonek. Il
tranche ainsi à sa manière le dilemme activisme/quiétude: il replonge
dans les traditions juives/yiddish tout en refusant l’activisme
sioniste/moderniste (et “simili-goy”). Mais Herzl est un disciple de
Birnbaum, qui ne retient que l’idée de revenir à la colline de Sion, d’y
créer un Etat où les juifs pourraient vivre la vie de citoyens modernes
normaux, selon les critères préconisés par Pinsker (et aussi, avant
lui, par Hess).
Théodore Herzl
 Jusqu’à la parution du petit livre de Théodore Herzl en février 1896, intitulé L’Etat juif,
le sionisme est une idéologie vague et confuse, affirmée puis
critiquée, acceptée puis reniée. Le livre de Herzl n’était pas moins
confus car il ne disait rien de précis sur le site géographique de ce
futur et très hypothétique “Etat juif”. Il pourrait se situer en
Palestine mais aussi ailleurs dans le monde. Son manifeste, bien que
confus, attire quelques personnalités influentes (Nordau, Kahn, Lazare,
Goldschmidt, Montagu, etc.) et recueille les signatures de milliers
d’étudiants juifs d’Europe centrale. Mais les assimilationistes et les
quelques colons de Palestine (issus du mouvement ‘Hovevei Zion) ne le
soutiennent pas, parce qu’ils craignent d’éveiller un nouvel
antisémitisme ou de voir les frontières des vilayets ottomans du Levant
se fermer à tous nouveaux arrivants par crainte d’une submersion. Herzl
développe alors une véritable “diplomatie sioniste” tous azimuts pour
tenter, vaille que vaille, d’arriver à ses fins, avec l’appui, non pas
d’une bourgeoisie juive assimilationiste, mais de dizaines de milliers
de petites gens qui n’ont guère d’espoir d’avancer socialement, surtout
en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette agitation autour de Herzl
va, suite au “Congrès de Bâle” d’août 1897, donner naissance au sionisme
moderne, autonome, capable, théoriquement, de faire avancer ses idées
sans le soutien d’une puissance impériale. Guillaume II d’Allemagne, qui
n’est certainement pas antisémite, décourage cette volonté romantique
de faire l’alya
(le retour à la Terre de Sion) pour ne pas heurter son nouvel allié
turc. Les Russes, qui auraient pu pratiquer à leur profit la politique
jadis préconisée par le Prince de Ligne ou Napoléon, répugnent à le
faire. Le rêve sioniste de Herzl ne pourra cependant pas se concrétiser
sans la “Déclaration Balfour” de 1917 qui donnera le coup d’envoi à la
colonisation massive des terres de Palestine par des colons juifs venus
d’Europe après la première guerre mondiale, surtout de Russie (ceux qui
refusaient la bolchevisation de l’Empire des Tsars comme Jabotinsky) et
d’Europe centrale, après les réactions hongroises et roumaines contre le
régime “judéo-bolchevique” de Belà Kun à Budapest.
Jusqu’à la parution du petit livre de Théodore Herzl en février 1896, intitulé L’Etat juif,
le sionisme est une idéologie vague et confuse, affirmée puis
critiquée, acceptée puis reniée. Le livre de Herzl n’était pas moins
confus car il ne disait rien de précis sur le site géographique de ce
futur et très hypothétique “Etat juif”. Il pourrait se situer en
Palestine mais aussi ailleurs dans le monde. Son manifeste, bien que
confus, attire quelques personnalités influentes (Nordau, Kahn, Lazare,
Goldschmidt, Montagu, etc.) et recueille les signatures de milliers
d’étudiants juifs d’Europe centrale. Mais les assimilationistes et les
quelques colons de Palestine (issus du mouvement ‘Hovevei Zion) ne le
soutiennent pas, parce qu’ils craignent d’éveiller un nouvel
antisémitisme ou de voir les frontières des vilayets ottomans du Levant
se fermer à tous nouveaux arrivants par crainte d’une submersion. Herzl
développe alors une véritable “diplomatie sioniste” tous azimuts pour
tenter, vaille que vaille, d’arriver à ses fins, avec l’appui, non pas
d’une bourgeoisie juive assimilationiste, mais de dizaines de milliers
de petites gens qui n’ont guère d’espoir d’avancer socialement, surtout
en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette agitation autour de Herzl
va, suite au “Congrès de Bâle” d’août 1897, donner naissance au sionisme
moderne, autonome, capable, théoriquement, de faire avancer ses idées
sans le soutien d’une puissance impériale. Guillaume II d’Allemagne, qui
n’est certainement pas antisémite, décourage cette volonté romantique
de faire l’alya
(le retour à la Terre de Sion) pour ne pas heurter son nouvel allié
turc. Les Russes, qui auraient pu pratiquer à leur profit la politique
jadis préconisée par le Prince de Ligne ou Napoléon, répugnent à le
faire. Le rêve sioniste de Herzl ne pourra cependant pas se concrétiser
sans la “Déclaration Balfour” de 1917 qui donnera le coup d’envoi à la
colonisation massive des terres de Palestine par des colons juifs venus
d’Europe après la première guerre mondiale, surtout de Russie (ceux qui
refusaient la bolchevisation de l’Empire des Tsars comme Jabotinsky) et
d’Europe centrale, après les réactions hongroises et roumaines contre le
régime “judéo-bolchevique” de Belà Kun à Budapest.Conclusion
Les
origines de cette idée sioniste, assortie d’une volonté de créer un
nouvel Etat au Levant, sur territoire ottoman, ne sont cependant pas
juives au départ. Elles résultent de calculs froids et cyniques de
militaires européens soucieux de briser la cohérence territoriale de
l’Empire ottoman en enfonçant, tel un coin, une entité nouvelle, à leur
dévotion, entre l’Egypte et l’Anatolie: cette entité envisagée a été
tour à tour juive, avec de Ligne et Napoléon, puis arabe, avec Abdel
Khader ou les Maronites occidentalisés. Pendant la première guerre
mondiale, les Britanniques avaient d’ailleurs parié sur les deux: sur
les Hachémites avec Lawrence d’Arabie, sur les juifs avec la “Jewish
Legion” et la “Déclaration Balfour”. Par conséquent, il ne serait pas
faux d’affirmer que tout sionisme pratique découle d’un calcul
stratégique non juif, parfaitement impérial, destiné à contrôler le
Levant et à affaiblir et l’Egypte (grande puissance potentielle au temps
de Mehmet Ali) et la Turquie ottomane: le “sionisme” des non juifs
n’est pas au départ une volonté de faire du “favoritisme” au bénéfice
des juifs; ce n’était ni le cas hier, où l’on était parfois
naturellement cynique, ni le cas aujourd’hui, où l’on camoufle ses
hypocrisies derrière une façade d’humanisme; le mobile principal est
d’avoir une population, quelle qu’elle soit —au départ exogène (les
Algériens d’Abdel Khader ou les juifs sionistes) ou minoritaire, en
conflit avec son environnement géographique et historique— mais qui
puisse toujours servir à créer un Etat-bastion pour disloquer les
territoires de l’ancien Empire ottoman, pour empêcher la soudure
Egypte/Anatolie, pour tenir l’ensemble de la Méditerranée jusqu’à son
“bout” sur les côtes du Levant, pour garder les approches du canal de
Suez, pour avoir une fenêtre sur la Mer Rouge (le port d’Elat à côté
d’Akaba en Jordanie). L’attitude de la Grande-Bretagne de Lloyd George,
désireuse d’affaiblir les Turcs et de créer une zone-tampon en lisière
du Sinaï et du Canal de Suez, pour protéger le protectorat britannique
sur l’Egypte, ne relève pas d’un autre calcul.
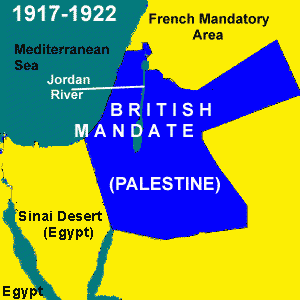
Les
Anglais, toutefois, voulaient un “foyer” juif et non un Etat juif car
ils devaient ménager leurs protégés arabes grâce auxquels ils avaient pu
chasser les Turcs du Levant. L’idée de “foyer” permet d’avoir un
territoire disloqué, présentant une mosaïque de diversités, sans
cohésion aucune et donc plus facilement contrôlable. Les sionistes
d’extrême-droite, dont l’idéologue principal fut au départ Vladimir
Jabotinsky, voudront un Etat en bonne et due forme et ne se contenteront
pas d’un simple “foyer”, immergé dans une population arabe majoritaire,
dont ils ne partageaient ni les moeurs ni les aspirations. Ces
sionistes radicaux, qui, au fond, ne voulaient de cette mosaïque
judéo-arabe envisagée par les stratèges londoniens, se révolteront
contre la puissance mandataire britannique en s’inspirant des écrits de
Michael Collins, le leader révolutionnaire irlandais, et de l’action de
l’IRA. Jabotinsky ne suivra pas ses disciples les plus virulents sur
cette voie maximaliste et terroriste: il était un officier britannique
de la “Jewish Legion”, d’origine russe, fidèle à l’Entente
franco-anglo-russe et hostile aux Bolcheviques de Lénine. Il restera
donc loyal à l’égard de l’Angleterre. Aujourd’hui, l’Etat d’Israël, né
en 1948, ne survit que pour une seule raison: il est la zone-tampon au
Levant dont se sert une nouvelle puissance impérialiste, américaine
cette fois, pour asseoir sa domination dans le bassin oriental de la
Méditerranée, pour tenir l’Egypte, la Syrie et, éventuellement, la
Turquie en échec.
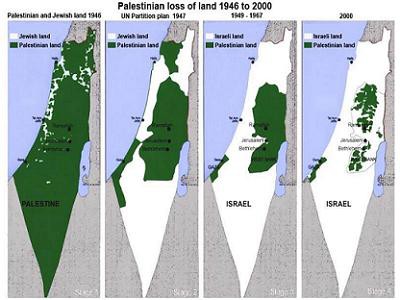
La
preuve la plus tangible de cette inféodation d’Israël à l’hegemon
américain est, bien entendu, la présence permanente de la flotte US de
la Méditerranée, qui y a évincé toutes les flottes européennes
riveraines, faisant automatiquement de l’Etat d’Israël la “tête de pont”
de cette redoutable flotte au fond de cette mer qui s’enfonce très
profondément dans les terres “eurafricaines” et qui, par cette
configuration géographique, a acquis pour l’éternité une importance
stratégique cardinale. Les Israéliens lucides, dubitatifs face aux
outrances de leurs gouvernants ou de leurs extrémistes, savent que ce
statut d’Etat-tampon est fragile sur le long terme: d’une part, ils
craignent aujourd’hui que les Etats-Unis ne reviennent à leur ancienne
alliance avec l’Iran, situation qui les déforcerait considérablement,
déplorent le chaos créé en Syrie, savent que les Etats-Unis ne peuvent
indéfiniment froiser le monde arabo-musulman, où ils perdraient alors
tous leurs avantages stratégiques. D’autre part, ces Israéliens lucides
commencent à réfléchir sur la fragilité des mythes sionistes (pures
fabrications?) avec l’école dite “post-sioniste” qui développe une
critique argumentée de l’idéologie et des pratiques du sionisme
réellement existant et s’interroge sur la substantialité réelle de toute
la mythologie politique de l’Etat d’Israël, né au lendemain de la
seconde guerre mondiale par l’afflux des “personnes déplacées”, suite
aux expulsions et déportations qui ont tragiquement marqué les années
1945-1950, où l’Europe n’était qu’un champ de ruines où régnait la
misère et la famine. Pour pallier ces doutes et ces inquiétudes, bien
présentes dans la société israélienne, les forces sionistes qui
structurent l’Etat hébreu comptent essentiellement sur deux facteurs:
sur l’électorat juif des Etats-Unis et, surtout, pour faire poids et
masse, sur les millions de “Christian Zionists” fanatisés par les
téléprédicateurs d’Outre-Atlantique. Tant que les juifs d’Amérique et
les “Christian Zionists” seront capables d’imposer et de ré-imposer, par
leurs voix, une politique pro-israélienne aux Etats-Unis, le rêve
sioniste des innombrables juifs jadis manipulés par les grandes
puissances restera réalisable mais dans la douleur et dans une tension
permanente, harassante, décourageante.
Robert Steuckers.
(Forest-Flotzenberg, Fessevillers, Genève & Nerniers, avril 2010; rédaction finale: mars 2013).
Bibliographie:
Delphine BENICHOU (éd.), Le sionisme dans les textes, CNRS Editions, Paris, 2008.
Alain BOYER, Les origines du sionisme, PUF, Paris, 1988.
Gudrun KRÄMER, Geschichte Palästinas – Von der osmanischen Eroberung bis zur Gründung des Staates Israel, Verlag C. H. Beck, München, 2002-2006 (5. Auflage).
Shlomo SAND, Les mots et la terre – Les intellectuels en Israël, Flammarion, coll. “Champs”, n°950, Paris, 2010.
Colin SHINDLER, Israel, Likud and the Zionist Dream – Power, Politics and Ideology from Begin to Netanyahu, I. B. Tauris, London, 1995.
Zeev STERNHELL, Aux origines d’Israël, Gallimard, coll. “Folio”, n°132, Paris, 1996-2005.
Commentaires
Enregistrer un commentaire